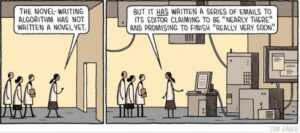De manière très générale, une ligne de démarcation sépare la science-fiction et la fantasy : leur rapport à la géographie et, plus particulièrement, au peuplement. La fantasy, dans son acception traditionnelle, se préoccupe davantage des espaces ruraux ou « sauvages »1 : un espace « pré-moderne (et rarement urbain) »i. Cela a certainement un rapport avec son intérêt pour la description de sociétés pré-industrielles. La SF, elle, se présente comme un genre plus urbain. Enfante du merveilleux scientifique du XIXe siècle, elle se plaît à mettre en scènes des mégalopoles tentaculaires, des cités spatiales ou même des œkuménopoles : des planètes entièrement recouvertes par une seule ville, à l’image de la capitale de la galaxie Coruscant, dans Star Wars, ou de son inspiratrice, Trantor, centre de l’Empire Galactique de Fondation. De fait, la ville, la conurbation, la métropole se sont durablement installée au cours du XXe siècle comme l’horizon figuratif du progrès et de l’avenir : la concentration urbaine est présentée comme une conséquence nécessaire de l’évolution des sociétés, à la faveur de « transitions démographiques ». Le programme d’histoire-géographie des classes de 6e comporte même une séquence où les jeunes élèves sont censés comprendre et questionner « les grands défis de la ville de demain ». La chose urbaine est donc l’objet d’une production imaginaire intense, très largement dépolitisée.
Les littératures de l’imaginaire ont donc un attrait logique pour la tension entre « ville » et « campagne ». Cet intérêt pour la chose urbaine et la structuration géographique – et même souvent « kosmographique » – est un angle particulièrement fertile de la politisation des imaginaires : en créant des mondes fictifs, les producteurs d’imaginaires questionnent nécessairement l’organisation matérielle de la cité toute entière. Dans la science-fiction, la ville est avant tout un espace technologique et ce, quelque soit le point de vue des auteur-ices. Pour développer mon propos, je prendrai deux exemples que quatre-vingts ans séparent : Ravage, de Barjavel, paru en 1943 et Terra Humanis de Fabien Cerutti, paru en 2023.
Ces deux récits ont pour point commun de présenter des civilisations humaines capitalistes ultra urbaines, confronteés à une catastrophe structurelle : une panne d’électricité générale et inexpliquée dans Ravage et le changement climatique dans Terra Humanis. Ce n’est pas le seul point commun, mais il faut déjà mentionner la plus grande différence : dans un cas, la ville technologique – en l’occurrence, Paris ou « Néo-Paris » – est le point de départ du récit, dans l’autre il s’agit de son issue.
Chez Barjavel, la ville technologique est présentée comme un repoussoir. Le personnage principal, François Deschamps, fils de paysan venu de la campagne reculée, ne cesse de déplorer les changements de mode de vie. Il se montre particulièrement nostalgique, pour ne pas dire réactionnaire. « Ah, c’était le bon temps », s’exclame-t-il en écoutant à la radio une « rétrospective » musicale intitulée « La vie à Paris en 1939. » Paris, apprend-on, a été entièrement reconstruite selon les plans d’un architecte nommé « Le Cornemusier » (sic), à l’exception du « Sacré-Coeur, ce spécimen si remarquable de l’architecture du début du XXe siècle, chef d’œuvre d’originalité et de bon goût. » Cette ville, et toute les autres ont outrepassé les limites naturelles, elles « s’étaient déformées, étirées le long des voies ferrées, des autostrades, des cours d’eau. Elles avaient fini par se rejoindre et ne formaient plus qu’une seule agglomération en forme de dentelle, un immense réseau d’usines, d’entrepôts, de cités ouvrières, de maisons bourgeoises, d’immeubles champignons. » La ville est évidemment peuplée d’un « un peuple dense coulait lentement d’une lumière à l’autre », envahie d’« un bruit continu, que murs, portes et fenêtres étaient impuissants à contenir au-dehors. » et, surtout déshumanisée. Les caissières, remplacées par des machines, y font de la figuration : « elles n’encaissaient plus rien. Elles ne parlaient pas. Elles bougeaient peu. Elles n’avaient rien à faire. Elles étaient présentes. Elles engraissaient. ». L’humanité s’est complètement coupées de ses racines, et mène une vie artificielle au point que « Légumes, céréales, fleurs, tout cela poussait à l’usine, dans des bacs ». Heureusement, s’exclame François, « La Nature est en train de tout remettre en ordre ». Après un appel à l’Apocalypse de Saint Jean en exergue, François condamne l’hubris des « hommes » (sic) qui ont cru se rendre « maîtres » de la nature et « on nommé cela Progrès », alors que ce n’est en réalité qu’« un progrès accéléré vers la mort ».
Comme pour Barjavel, pour Fabien Cerutti, la vitesse représente le progrès technologique – et donc le progrès tout court. D’ailleurs, c’est sur cette image que s’ouvre son roman : « Rébecca Halphen file à vive allure dans la bulle du Light-tram magnétique qui la ramène à Néo-Paris. », incipit qui fait écho aux « automotrices » de Barjavel qui relient Marseille à Paris en « à peine plus d’une heure ». Les « œufs » de Terra Humanis « fendent l’azur » sur leur « équilibreur de gravité », « à la vitesse compensée de 1200km/h. »
À la différence de Barjavel, Cerutti2 considère lui que le progrès technologique mènera l’humanité vers une société parfaite, pourvu qu’il soit initié et dirigé par des hommes et des femmes exceptionnelles. Il rejoue ainsi la théorie saint-simonienne d’une sorte « d’aristocratie des talents », (dont l’essentiel de ses personnages sont explicitement issus). L’utopie citadine et technologique n’est donc possible que grâce à l’action de Rébecca, dotée d’un « QI de 250 » et d’« une précocité inouïe, une grande intelligence sociale, d’intuition, d’empathie, et d’une profonde sensibilité », sans compter que « ses capacités d’analyse et sa logique repoussent les plafonds », et de Luc son condisciple, époux et plus proche collaborateur, qui possède lui « une mémoire eidétique ». La création d’une utopie scientifique est donc le fait de caractères prodigieux, que leur capacités met à part de l’espèce humaine ; ainsi la maxime randienne prononcée par la mère de l’héroïne, « On n’empêchera jamais les imbéciles d’avoir une dent contre les grosses têtes. »
Aux deux tiers du livre, on peut lire cet énoncé, comme une sorte de vœu pieux : « Il fallait bien admettre une chose, à partir du moment où la production d’énergie 100 % décarbonée ne posait plus de problème de réchauffement, que les ressources spatiales abondantes complétaient celles présentes sur Terre, et que les IA, robots et imprimantes 3D épargnaient aux êtres humains les tâches les plus ingrates, la vie pouvait se révéler agréable sur la planète. » Cette ébauche de « solutions » dissociées de leurs conditions d’existence, couplée avec la pratique du récit sommaire de Crutti fait écho avec la figure de la « skyline » (la silhouette des immeubles), image d’Épinal d’une ville dont on ne voit que les contours, semblable à la cité du futur du film Tomorrowland, paradis technologique vide et inaccessible.
Il y aurait des exemples sans nombre pour illustrer ce constat : près de deux siècles durant, les imaginaires hégémoniques ont cherché à construire une ville intégrale, autosuffisante jusqu’à l’autarcie et, surtout, ne remettant aucunement en cause les principes économiques et sociaux qui préside à sa construction. C’est le reflet amoindri de ces villes fantasmées qui s’incarne aujourd’hui dans les promesses faussement émancipatoires de « villes connectées », « villes intelligentes », et mêmes « écologiques », jaillies du désert ou étalées à l’horizon toujours plus loin hors des boulevards périphériques. Si les producteurs d’imaginaires ont commis une faute, c’est peut-être de ne s’être arrêté qu’à la surface bétonnée de la promesse de progrès et, ce faisant de n’avoir pu imaginer que la reproduction et l’amplification du même.
*
L’imaginaire figuré par le roman de SF dans lequel nous habitons semble donc être obsolète, fondé sur des représentations vieilles de près d’un siècle tout en revendiquant une innovation et une nouveauté perpétuelles. Cette domination hégémonique est une manière pour les institutions étatiques et capitalistiques de se justifier ainsi que de chercher à perpétuer leur pouvoir. Au reste, cet imaginaire « illimitiste »ii, que ce soit spatialement (appropriation de l’espace extra-terrestre) ou temporellement (repousser les limites de la longévité humaine, par la science médicale ou par la cryogénisation), participe d’une idéologie hégémonique délétère et même mortel : celui d’une croissance infinie au sein d’un monde fini.
L’imaginaire, et particulièrement celui du futur, est sujet à une appropriation et à une volonté hégémonique de la part des institutions idéologiques du capitalisme , qu’il s’agisse des consortiums industriels ou des agences (para)étatiques. Cependant, des forces minoritaires leur contestent cette hégémonie. Selon la formule d’Alice Carabédian, elles cherchent à produire des imaginaires, ni « sur le modèle du conquistador, ni sur celui de l’ingénieur ». Pour politiser les imaginaires, il faut avec elle faire acte de résistance imaginative contre ce roman de science-fiction qui « se présente comme le Réel ».
1 Il ne s’agit bien sûr que d’une affirmation très générale. Des contre-exemples existent : la cité d’Ankh-Morpok chez Terry Pratchett, les villes de Gemina et Dehaven chez Claire Duvivier et Guillaume Chamandjian, Olangar chez Clément Bouhelier, etc.
2 Je me permets de citer l’auteur nommément, et non pas le narrateur, car, dans son introduction, Fabien Cerutti revendique pour lui-même les idées développées dans le roman.
i Fredric Jameson, « Radical Fantasy », Historical Materialism, Vol 10 #4
ii Johan Chapoutot, Le Grand récit, Presses Universitaires de France, 2021