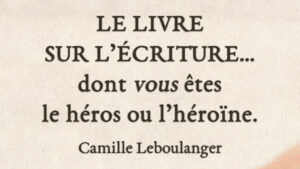Quelle drôle d’idée !
C’était en 2023. En revoyant Le Jeune Karl Marx, le film de Raoul Peck (2017) – qui est au fil des années devenu un de mes films « doudous », c’est vraiment une chouette bromance – je me suis dit tout d’un coup qu’il serait intéressant de faire un livre ou un film qui se concentrerait sur la figure de Jenny Marx, superbement jouée ici par Vicky Krieps.
Me voilà donc parti, par curiosité d’abord, dans la lecture de tout un tas de biographies existantes. Forcément, on se doute que la quantité de littérature écrite autour de Jenny est bien faible face à celle à propos de son mari. Il existe à ma connaissance trois livres sur Jenny Marx : Jenny la rouge de Heinz Frederick Peters, professeur étatsunien, paru en 1986, Jenny Marx ou la Femme du Diable (oui oui), publié en 1992 par Françoise Giroud, patronne de presse et ancienne ministre sous la présidence de Valery Giscard d’Estaing, et le plus récent, Jenny Marx ou la tentation bourgeoise, par Jérôme Ferenbach, ex-inspecteur des finances et directeur du Conseil Général du Notariat.
Dans deux cas au moins, on ne pouvait soupçonner les auteur·ices de complicité avec le sujet de leur livre. Les livres de Giroud et Ferenbach me laissèrent l’impression de ne porter sur Jenny que pour mieux attaquer son mari, tout en se livrant à des jugements moraux assez lunaires1. Surtout, ils manquaient à mon sens de réflexivité sur leur propre point de vue, et sur leur posture.
J’ai d’abord voulu faire un roman. Je n’ai pas réussi. D’abord parce qu’il me semblait qu’il y avait trop de choses à dire et à expliquer à propos de son siècle pour comprendre la vie de Jenny. Je dis « son siècle » car sa vie le recouvre en grande partie : de 1814 à 1881, de Trèves à Londres, d’un empire aristocratique à un empire capitaliste. Je n’ai pas choisi de la faire parler elle-même, au risque de la trahir. Enfin, je ne voulais pas risquer d’en faire une héroïne ou un mythe. Je voulais tenter d’approcher sa personne, non son personnage. Les scènes de fiction de ce livre sont là dans ce but.
Quelle vérité gardons-nous de Jenny Marx ? Probablement aucune. Ce que j’ai tenté de faire dans ce livre, c’est d’observer les traces qu’elle a laissées dans l’espoir de reconstituer son parcours, pour le comprendre de mon propre point de vue. C’a été une longue enquête, de quasiment deux ans, à travers des pages et des pages de correspondance intimes, philosophie allemande, théorie féministe et synthèses historiques.
Comme le travail de Karl Marx, le mien s’appuie et se nourrit sur celui de dizaines d’autres. Sans tout le travail de Jenny, Karl n’aurait pas produit le sien. Ce que j’ai souhaité faire, c’est de donner à voir la part du travail reproductif oublié, masqué, rendu invisible par (bientôt) des siècles de théorie révolutionnaire, ce travail premier et absolument nécessaire à tous les autres. J’ai cherché à montrer tout ce que la pensée et la lutte révolutionnaires doivent à Jenny Marx, à Hélène Demuth et à sa sœur Marianne, à Jennychen, Laura et Eleanor, à Mary et Lizzie Burns. La liste, comme leur travail, n’a ni début ni fin.
Écrire sur Jenny Marx, c’est écrire sur une absence. Des centaines, milliers de lettres qu’elle a dû écrire au cours de sa vie, il n’en reste que quelques dizaines. Son unique texte autobiographique est paru en France en 2013 ; il n’a jamais été réédité. Son mari a écrit sur elle. Ses filles aussi. Engels a prononcé son éloge funèbre. Mon livre, mon point de vue, s’ajoute maintenant à tous les autres.
J’espère qu’il n’en prendra pas la place, mais qu’il sera lu comme la couche la plus récente d’un palimpseste : celle que forme tout ce qu’on écrit, tout ce qu’on dit, ce qu’on sait et ce qu’on ignore à propos de Jenny Marx, née Von Westphalen.
Jenny Marx – Vivre et Lutter avec Karl, éditions Textuel, 26 février 2025. https://www.editionstextuel.com/livre/jenny_marx_vivre_et_lutter_avec_karl
1 J’en parle dans le livre, mais le bouquin de Françoise Giroud est assez croustillant. Il est indisponible, mais se trouve assez facilement en librairie.