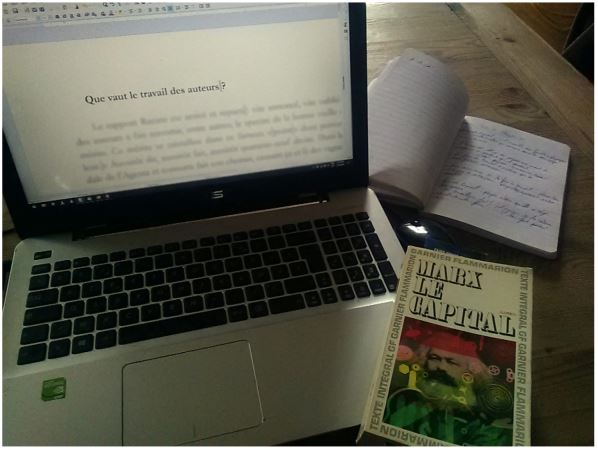Le rapport Racine est arrivé et reparti : vite annoncé, vite oublié. La contre-réforme de la gestion des retraites a fait ressortir, entre autres, le spectre de la bonne vieille « valeur travail » sous la forme du « mérite ». Ce mérite se cristallise autour dee ce fameux « point » dont personne ne connaît justement la « valeur. » Aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt quarante-neuf droite. Dans le milieu de l’édition, le petit scandale de l’Agessa et consorts fait son chemin, causant ça et là des vaguelettes. Des voix s’élèvent toujours pour réclamer la définition d’un statut particulier de l’auteur (j’utiliserai ici le terme « écrivain » comme métonymie de toute activité artistique) dans le régime de Sécurité Sociale et aussi dans cet impénétrable « système universel. » L’intention, au moins, est louable.
Cependant, je m’interroge. La position de l’écrivain dans l’ordre de la production économique est-elle justement si originale, si singulière ? Qu’y-a-t-il de tellement particulier dans son travail et dans la valeur que celui-ci produit ? L’écrivain, décrit comme travailleur « indépendant » par excellence, est-il réellement différent des autres ? En somme, la question que je me pose est la suivante : « Quelle est la valeur du travail de l’écrivain ? »
Pour être tout à fait clair, je dois en premier lieu préciser l’acception du terme « valeur » que j’utiliserai ici. Dans un précédent article, je faisais à la suite de Bernard Friot la distinction entre « valeur d’usage » et « valeur économique ». C’est de cette dernière dont je vais parler aujourd’hui. Il ne sera donc pas question du contenu des œuvres, de leur genre, ni même de leur qualité. Ces catégories-ci seraient plus logiquement rangées dans la « valeur d’usage » : ce livre est-il bon ? Me fait-il éprouver du plaisir esthétique ? M’instruit-il ? etc. On verra que cette « utilité sociale » est totalement indifférente à l’ordre de la production. Voilà pour la valeur, à comprendre donc comme « valeur économique » et ce qui la représente le plus couramment, à savoir la monnaie. En bref, je parlerai d’argent.
Au travail, maintenant. Entendons le terme « travail » comme activité productive. Le travail est l’acte de produire quelque chose. Je pars du principe que l’écrivain est bel et bien un travailleur, un producteur de valeur au même titre que, par exemple, un mécanicien. L’activité de l’écrivain, d’une manière ou d’une autre, fera apparaître de l’argent nouveau.
Une fois ces définitions posées, je dois avant de continuer faire un pas en arrière. Pour tenter de résoudre clairement la question du travail des écrivains (et celle, fort liée, de leur position sociale dans l’ordre de la production), je dois revenir à ce que Marx appelle dans Le Capital la « formule générale du capital ». Cette formule est la suivante. Pour qu’il y ait création d’un capital, et non simple circulation de marchandises et d’argent de valeur égale, un « reflux » d’argent doit avoir lieu vers sa source. En somme, l’argent doit devenir de l’argent. Le capital, c’est acheter pour vendre ensuite. Marx résume ce fonctionnement ainsi : A-M-A, soit Argent-Marchandise-Argent. Ou plutôt : A-M-A’. En effet, il n’y a création de capital que si la quantité d’argent qui revient est supérieure à celle qui part. Ainsi : A’ > A. Mettons que j’achète pour cent euros de gel hydroalcoolique. Si je le revends au même prix, nul capital. Par contre, il suffit que je le revende cent-dix euros et nous y sommes. J’aurais effectué une « plus-value » dont l’accumulation constitue le capital.
Durant les cours de Technologie que j’ai reçus au collège, cette « plus-value » m’avait été désignée comme un « bénéfice » : un gain, un profit. Du latin « beneficus », un bénéfice est littéralement un « bienfait. » On comprend donc que la réalisation de cette plus-value est l’objectif de toute organisation capitaliste et présenté systématiquement comme quelque chose de positif.
Où se situe l’écrivain dans cette formule ? Occupé à rédiger un roman ou un essai, le travailleur écrivain ne joue pas le rôle du « possesseur d’argent ». Admettons qu’il ait en sa possession un manuscrit achevé (je reviendrai sur les conditions de production du-dit manuscrit), il ne le mettra en échange que par la formule inverse : M-A-M’. M (la marchandise) est ici le manuscrit. A est la somme d’argent que l’écrivain cherche à obtenir en échange du manuscrit. M’ représente l’ensemble des autres marchandises que l’argent obtenu lui permettra de se procurer. La position de l’écrivain n’est donc pas ici capitaliste en ce qu’il n’y a pas reflux d’argent. Le rapport est inversé. La monnaie valeur ne joue ici qu’un rôle de médiateur entre deux marchandises. Elle n’existe virtuellement pas. Lorsque l’écrivain vend son livre, il réalise en vérité un troc.
Revenons à la formule générale de Marx. Tentons de l’appliquer à la tant discutée chaîne du livre. Où l’écrivain se situe-t-il en elle ? À première vue, au milieu.
On aurait donc : A Argent – MA Manuscrit – A’ Argent. Si l’on se place dans un contexte d’édition classique (dit « à compte d’éditeur »), il faudrait la réécrire comme ceci : À-valoir ou Avance – Livre – Chiffre d’affaire contenant une plus-value. Lors de la signature du contrat d’édition, une avance sur droits est versée à l’auteur. Cela, ajouté aux frais intermédiaires (impression, promotion qui ne regardent que de loin, en principe, le travailleur écrivain car ne relevant pas de sa compétence dans l’échange) constitue la somme d’argent nécessaire à l’achat, à la matérialisation de l’objet livre dont le commerce permettra le retour de l’argent « investi » avec en toute logique une plus-value. Je ne ferai pas l’erreur d’oublier que la personne morale que l’on nomme « l’éditeur » n’est pas seule en échange face à l’auteur. Je simplifie volontairement et demande, pour le bien de la démonstration, qu’on accepte d’y inclure la distribution-diffusion, les librairies et autres acteurs commerciaux du livre. Eux-même sont d’ailleurs saisis dans d’autres transactions A-M-A’.
Le problème de cette formule est le suivant. Tout comme la formule M-A-M amène la disparition du A Argent et peut se résumer en troc (M contre M), la formule A-M-A’ conduit également. à l’effacement de la marchandise. Comme la visée du mouvement capitaliste est l’accumulation de la plus-calue, on peut dire que l’argent appelle l’argent : A-A’. C’est ce que l’on nomme poliment de la « finance ». La marchandise, sa nature et ses qualités, n’ont aucune espèce d’importance. Peu importe quel livre est vendu, pourvu qu’il soit vendu et qu’on en tire une plus-value. Voilà une explication probable de la surproduction de l’édition francophone.
D’autant que, comme le montre Marx dans la Deuxième Section, Chapitre VI du Capital, ce n’est pas n’importe quelle marchandise qui est représentée par le M et dont la revente aboutit à la constitution de la plus-value. En vérité ce n’est pas un livre, ni même le texte d’un livre ou l’idée d’un livre que l’éditeur achète au travailleur-écrivain. Ce que l’éditeur achète c’est la force de travail de l’écrivain. Cette force de travail, Marx la définit comme suit. Il s’agit de « l’ensemble des facultés physiques et intellectuelles qui existent dans le corps d’un homme [ndA : ou d’une femme, évidemment] ». Ce que l’éditeur pris dans le rapport de production capitaliste achète n’est pas le résultat du travail de l’écrivain, mais sa capacité à écrire. Voilà ce que c’est pour un écrivain que revendiquer le terme de travailleur. C’est dire : « Je ne vends pas le fruit de mon effort, mais mon effort lui-même. » Le livre n’est que la conséquence de la force de travail de l’écrivain1. Acheter le travail d’un écrivain, c’est donc acheter son travail potentiel. Cette idée est nettement contraire au mouvement capitaliste qui anime l’édition, puisque celle-ci est une activité commerciale saisie dans le rapport de production sociale capitaliste. Acheter la force du travailleur, c’est décorréler le travail de son produit. Le capital, lui, cherche toujours à faire baisser le prix de la force de travail en fonction du produit.
On tient là une première réponse à notre question. Ce que vaut le travail d’un écrivain, c’est sa force d’écrire. J’en reviens à Friot : le salaire est versé, non pas contre pièce ou durée horaire, mais qualification ou potentiel d’application d’une force de travail.
Pour continuer, je voudrais m’appuyer sur deux citations de Marx, toujours dans le Capital, afin de préciser la position sociale de l’écrivain. Je le rappelle : il faut comprendre le capital comme une organisation de rapports sociaux. Le capital n’est pas inévitable, pas plus qu’il n’a toujours été. Il est le résultat d’une construction sociale de longue durée. Il s’agit d’un rapport social conditionnant. En terminer avec le capitalisme est donc une lutte en actes et qui prendra du temps. Coluche disait, avec beaucoup d’à propos : « Quand on pense qu’il suffirait que les gens n’achètent plus pour que ça ne se vende pas ! ». L’écrivain et l’éditeur ne peuvent s’extraire d’un rapport capitaliste qu’en choisissant de changer entièrement de rapport.
Première citation : « L’homme est obligé de consommer avant de produire et pendant qu’il produit. » Le travailleur « doit pouvoir recommencer demain ». Le prix minimum de la force de travail est donc la « valeur des moyens de subsistance physiologiquement indispensables ». Revenons encore à notre formule M-A-M’. Le travailleur écrivain, au cours de la durée de son travail, doit assurer sa subsistance, la reproduction matérielle de sa force de travail. Disons le simplement : pour pouvoir écrire, il faut manger. C’est là que le modèle capitaliste de l’édition atteint sa limite fondamentale : il n’est même pas capable d’assurer la subsistance minimale de la force de travail qu’il emploie ! Ces besoins fondamentaux n’incluent évidemment pas non plus les frais spécifiques au travail de l’écrivain, comme l’achat de livres ou de matériel. Ainsi, le travailleur écrivain n’a d’autre choix que de vendre sa force de travail en même temps dans un autre secteur de production. La faiblesse structurelle et systématique des revenus du domaine éditorial l’y contraint (il faut concéder au rapport Racine que, s’il se trompait dans les analyses et les perspectives, ce constat était fait, et bien fait, largement étayé). On voit donc comment la « professionnalisation » (comprendre : se consacrer uniquement à ce travail) des écrivains est majoritairement impossible dans le capital.
Deuxième citation : « La force de travail est payée alors qu’elle a déjà fonctionné », écrit Mars. Il ajoute : « Le travailleur fait […] l’avance de la valeur usuelle de la force. ». Au capital, « il lui fait partout crédit ». On retrouve ici le terme d’« avance ». Ainsi, lorsque j’achète du gel hydroalcoolique, le prix payé ne recouvre pas les coups de subsistance de celui qui l’a fabriqué. Ces coûts-là, c’est le travailleur qui les a assumé et le salaire vient rembourser la dette que son employeur contracte à son endroit.
Dans le domaine de l’édition professionnelle, l’avance est également appelée « à-valoir » et consiste en une somme versée par l’éditeur à l’auteur au moment de la signature du contrat d’édition. Cette somme est censée représenter une quantité de « droits d’auteurs » que l’écrivain touche avant la vente réelle du livre. Il ne touchera des revenus supplémentaires de droits d’auteurs que lorsque le nombre de livres vendus aura « épongé » cette somme. Chaque année, l’éditeur « rend les comptes » à l’auteur et il n’est pas rare que l’écrivain soit indiqué comme « débiteur » car le total des ventes n’aura pas recouvré la somme avancée. Dans un formidable retournement, l’écrivain devient donc endetté envers son éditeur. Or, Marx nous montre exactement le contraire ! Puisque l’avance sur droit arrive après coup, après rédaction du texte, c’est précisément l’éditeur qui est endetté envers le travailleur écrivain dont il projette d’acheter la force de travail. C’est toujours l’écrivain qui fait à l’éditeur l’avance de sa force de travail, et non l’inverse. Dans certains cas, bien sûr, l’avance sur droit est faite au lancement du « projet », mais ce décalage temporel n’invalide pas le reste. On voit donc que la forme même du « compte d’auteur » est un des nœuds du problème.
Comment une telle contradiction peut-elle exister ? La raison est simple. Le contrat d’édition tel que pratiqué ne reconnaît pas la force de travail de l’écrivain. Il ne le reconnaît pas comme travailleur. Le contrat d’édition paye l’écrivain à la pièce ; l’exemple le plus probant aujourd’hui de travail à la pièce étant bien sûr la course Delivuber. Par le contrat d’édition, l’auteur vend la jouissance de son travail achevé (déjà payé, puisqu’il faut bien manger pendant qu’on écrit ! ) à l’éditeur qui n’a comme responsabilité que d’en assurer la commercialisation et la promotion, domaines dont la mise en œuvre n’est que rarement précisée. Si cette commercialisation est infructueuse (pour toutes les raisons dont le rapport Racine fait bien le constat), la faute financière n’en revient jamais à l’éditeur, puisque l’écrivain reste administrativement débiteur de la contre-avance qui lui a été faite !
Un discours souvent entendu parmi les professionnel de l’édition peut se résumer ainsi : « On ne sait jamais vraiment pourquoi un livre se vend ! ». Au contraire, la raison de son échec est nettement formalisée lors de la reddition de comptes. L’écrivain débiteur en est rendu coupable formellement alors que la commercialisation n’entre pas dans ses attributions. Il est convenu par ailleurs que l’écrivain se rend disponible – lui, sa force de travail constitutive, etc. – pour assurer la promotion du livre produit. Le mouvement « Paye ton auteur » s’est insurgé contre la gratuité des interventions dans les événements publics (types Salon du Livre), exigeant leur paiement. Noble intention. Sauf que ce paiement est majoritairement versé en droits d’auteurs, tout comme le fameux à valoir. Qu’ont ces deux revenus en commun ? Ils ne reconnaissent pas la vente de la force de travail, ni la production de valeur du travailleur écrivain. Ne reconnaissant pas du travail, ils ne sont pas considérés comme du salaire !
Voilà la source de la non-qualité de l’écrivain comme travailleur. L’écrivain, comme tout travailleur, fait à l’entreprise de type capitaliste qui l’achète, l’avance de sa force de travail. Cette dette de l’acheteur de la force, qui espère en tirer une plus-value, s’explique par la nécessité de subsister pendant le travail, exactement de la même manière que chaque salarié fait l’avance à son employeur puisque son salaire est versé en fin de mois et non au début (contrairement au loyer et autres factures). L’emploi capitaliste achète à crédit la force de travail, et ce en toute impunité. Personne se rend dans un magasin pour acheter le gel hydroalcoolique cité plus haut en le payant plus tard. L’édition capitaliste achète donc également à crédit. Le droit d’auteur ne reconnaît pas un travail mais le droit patrimonial/matrimonial à jouir des fruits de l’exploitation de l’œuvre de son esprit. « Exploitation » : tout est dit. Masquée derrière lui, l’édition escamote la force de travail des travailleurs écrivains.
Il faut, pour changer le rapport de travail entre éditeur et écrivain, reconsidérer profondément le contrat d’édition afin que celui-ci ne sanctionne pas seulement une transaction commerciale capitaliste et inégalitaire mais forme au contraire une forme particulière du contrat de travail qui engage la responsabilité de l’employeur.
Ce rapport social fragilise donc l’écrivain comme tous les autres travailleurs. Ce travail effectif et concret ne doit plus disparaître derrière les revenus liés aux droits d’auteur. Le dicton dit simplement : « Tout travail mérite salaire. » Que vaut le travail des écrivains ? Du salaire. En tant que travailleurs, c’est un salaire reconnaissant leur force de travail que les écrivains doivent exiger. Je reviens une dernière fois à Marx. Pour lui, toute lutte cherchant à augmenter le prix de la marchandise travail (les salaires) est une lutte défensive et nécessaire. Exiger une augmentation des avances sur droit et des pourcentages est donc nécessaire. Cependant, même si le prix de M augmente, la plus-value de A’ échappe toujours à la circulation. Le capitalisme n’est pas ébranlé. Toute lutte offensive ne peut donc être que politique. Elle doit aspirer à remettre en question le rapport social (le capitalisme) dans lequel nous sommes saisis. Que l’écrivain s’affirme ouvertement comme travailleur et réclame un salaire est un premier pas.
1« La force de travail se réalise par sa manifestation extérieure. » Marx, Le Capital, Deuxième Section, Chapitre VI.