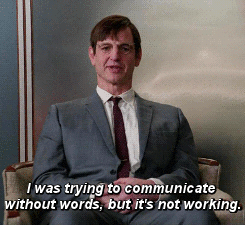Dans son livre Que fait la police ? (et comment s’en débarrasser)1, Paul Rocher cite les historiens Berlière et Levy qui écrivent, au sujet de la notion de « professionnalité » : « Une fonction sociale se professionalise [c’est moi qui souligne] lorsqu’elle est prise en charge par un personnel spécialisé, dont le recrutement, la formation, l’affectation, la carrière, sont organisées de manière spécifique. »2
Berlière et Levy parlent bien sûr ici de la police et on voit aisément comment cette définition s’y applique. La police est en effet une institution à part dans la société (Rocher montre d’ailleurs comment elle tend, pour dire le moins, à s’autonomiser), dont les membres sont recrutés et formés selon des normes juridiques, sociales, morales et politiques singulières de manière à former un corps homogène3.
Cette définition est-elle applicable aux écrivain·es ? La revendication de « professionnalité » portée par certains écrivains a-t-elle un sens ? Une professionnalisation est-elle souhaitable ?
À première vue, les écrivains et écrivaines ne paraissent pas remplir les critères nommés par Berlière et Levy. Si l’on admet que pratiquer la littérature écrite relève d’une fonction sociale particulière (ne serait-ce que symboliquement), celle-ci ne fait l’objet d’aucune formation particulière organisée de manière institutionnelle ; c’est à dire qu’il n’existe pas de cursus « professionnalisant » pour devenir écrivain·e. Le recrutement dans le champ des écrivain·es reconnu·es comme tel·les se fait de manière arbitraire (l’édition choisit, en gros) et répond à des critères sociologiques mal étudiés encore (qui écrit ? Qui publie ? Qui écrit quoi ? Qui publie quoi ?). En tant que groupe social, les écrivain·es ne montrent aucune uniformité, bien que des phénomènes de concentration « en haut » tendent à créer une « sous-classe » d’ écrivain·es pauvres tourbillonnants autour d’écrivain·es riches (financièrement, symboliquement, légitimement, etc.). Enfin, il ne semble pas exister d’opinion politique majoritaire chez les écrivain·es.
Au sens où l’entendent Berlière et Levy, les écrivain·es ne sont donc pas des professionnels.
Pourquoi existe-t-il donc une Ligue des Auteurs Professionnels, qui revendique comme but explicite de « créer le statut de l’auteur professionnels ? »4 Cette revendication de professionnalisation me semble double.
D’une part, la « Ligue » fonctionne comme un syndicat, venant en aide aux adhérent·es dans des situations spécifiques à son champ d’action. Son travail a pour but de réclamer des droits sociaux supplémentaires ou simplement l’application des textes législatifs. En tant que syndicat, elle joue le rôle de « partenaire social », en interaction et opposée à la puissance publique (en l’occurrence, le Ministère de la Culture) et d’autres organisations comme le Syndicat National de l’Édition. Elle peut également mener des actions de lobbying auprès d’élus, dans le but d’obtenir une reconnaissance spécifique du statut des auteur·ices. Cette action cherche à améliorer leur situation matérielle : revenus, droits sociaux, etc.
D’autre part, la revendication de « professionnalisme » procède d’une inquiétude plus symbolique. En se disant « professionnelle », la Ligue dit en somme : « Les auteurs sont détenteurs de savoirs, de capacités spécifiques méritantes d’êtres reconnues comme telles. Ielles savent faire des choses que d’autres ne savent pas faire, ou savent les faire mieux. » Ces deux arguments sont évidemment recevables. Comme toute catégorie de personne qui s’applique à un métier, les écrivain·es ont développent des savoir-faire particuliers, pour la bonne et simple raison qu’ils y passent beaucoup de temps. Simplement dit : c’est en forgeant qu’on devient forgeron ou, en l’occurrence, c’est en écrivant qu’on devient écrivain·es. Si on trouve des écrivain·es pour appeler de leurs vœux ou applaudir (ou participer à) la création de cursus de formation spécifiques (comme les Master d’écriture créative, ou encore nombre de formations accessibles désormais par le célèbre CPF)5, cette revendication de « statut » les prend moins pour objet qu’une place symboliquement spécifique dans le corps social. Être professionnel serait être reconnu comme, non seulement compétent, mais aussi utile et surtout bien vu.
Cette insécurité symbolique prend au moins en partie sa source dans une insécurité matérielle. Pour l’immense majorité des écrivain·es, l’écriture et la publication n’est pas une source de revenus suffisante et ceux-ci doivent donc être complétés par une autre activité, salariée ou non.
Le régime néolibéral a ceci de particulier, dans le domaine symbolique, qu’il travaille le langage en profondeur. Il saisit des mots déjà investis de significations et porteurs d’affects, se les approprie, les évide pour mieux les remplir d’un sens (je pourrais presque dire, d’une direction) nouvelle, de sorte qu’en les utilisant, on valide à son corps défendant des idées avec lesquelles on se pense en désaccord.
Le piège est le suivant :
En revendiquant une professionnalité, les écrivain·es ne demandent pas ce qu’iels croient. Ielles pense exiger une forme spécifique de protection sociale en accord avec leur activité6 mais clament au contraire leur accord avec l’atomisation sociale néolibérale.
Dans Imaginaires du néolibéralisme7, Lionel Ruffel montre comment les écrivain·es sont amenés à multiplier les « activités annexes » (signatures, rencontres, festivals, ateliers, spectacles, etc.) qui remplissent la double fonction de sources revenus financiers et de publicisation de leur travail. L’entretien d’une « communauté » sur les réseaux sociaux, la diffusion en direct de ses séances d’écriture en sont l’une des formes les plus récentes. Le choix de « l’autoédition » procède à mon sens de la même dynamique.
Pour être « professionnel », un·e écrivain·e doit le montrer, et le démontrer. Iel doit le dire, l’affirmer. Autrement dit, iel doit le professer : revendiquer sa spécificité, son autonomie., etc., tout comme iel doit faire la preuve de sa légitimité pour remplir des dossiers de demandes d’aides et de subventions. Iel doit, comme n’importe quel autre individu dans une organisation néolibérale de la division sociale du travail, être à la fois producteur et investisseur en lui-même, et surtout en donner la preuve par le recul nécessaire à l’autopromotion.
L’organisation néolibérale du travail lui en fournit même les moyens parfaits : auto-entreprenariat, micro-entreprise, etc. Le monde de l’édition et de la production culturelle y est particulièrement adepte. Lorsqu’en 2017, l’AGESSA affirma que les directeurs de collection ne pouvaient plus être payés en droits d’auteurs, les grands groupes éditoriaux ont réagi, non pas en requalifiant les-dites directeur·ices en salariés… mais en leur proposant de facture en tant qu’auto-entrepreneur·ices8. On remarquera que personne ne conteste aux directeur·ices de collection leur « professionnalité »…
L’exemple des professeurs de l’éducation nationale (et du new public management de manière générale) peut être pertinent ici. Depuis une dizaine d’année, les ministères successifs (où l’on retrouvait presque toujours un certain Jean-Michel Blanquer à la manœuvre…) affirment répondre au « malaise des enseignants » en leur proposant une plus grande professionnalisation. En quoi consiste celle-ci ? En réalité, il s’agit de la technicisation, de la réduction de leur métier à un ensemble de compétences, évaluables (rouge/jaune/vert/bleu ; les parents d’élèves reconnaîtront), à la destruction des corps d’inspection indépendants ainsi que de la médecine du travail ainsi qu’à l’accroissement de ce que l’on appelle benoîtement « tâches administratives » : courriers électroniques, cahiers de texte, bulletins, réunions, etc. Pour le dire clairement, un enseignant « professionnel » n’est pas libre et responsable. Il est seul et soumis à l’arbitraire administratif, qu’il s’agisse de la direction de l’établissement, du rectorat ou du ministère.
En régime néolibéral, un professionnel est donc un individu seul, libre seulement de vendre lui-même ses « compétences » sur le marché du travail. Il n’est aucunement partie d’un ensemble de travailleurs partageants un métier. Il est en concurrence directe et absolue avec tous et toutes.
Je n’ai pas la prétention de trancher ici et maintenant la question de savoir si les écrivain·es occupent ou non une place spécifique dans la division du travail9, de nature à faire d’eux un corps social spécialisé, ou bien s’il est possible de se former, disons, « scolairement » à ce travail particulier. Ce dont je suis certain, en revanche, c’est qu’iels n’ont rien à gagner, en régime capitaliste, néolibéral, à se revendiquer professionnel.les.
1 Éditions La Fabrique, 2022.
2 Histoire des Polices en France. De l’Ancien Régime à nos jours, éditions du Nouveau Monde, 2011
3 Ne serait-ce que politiquement. Selon l’enquête électorale 2017 du Cevipof, 54 % des policiers affirmaient avoir voté pour Marine Le Pen à l’élection présidentielle.
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_des_auteurs_professionnels
5 La question d’une formation spécifique en appelle d’autres, trop nombreuses et trop complexes pour que je m’y penche aujourd’hui : quels sont les savoirs et les gestes qui font un·e écrivain·e ? Comment ceux-ci sont-ils reconnaissables, et par qui ?
6 Au demeurant, on se demande bien pour quelle raison magique les puissances publiques de droite, alliées objectives de faire des intérêts des tenants du SNE, se trouveraient disposées à le leur accorder, dans un contexte de destruction systématique de la socialisation communiste de la valeur ajoutée.
7 Éditions La Dispute, 2016
8 Un statut à la couverture sociale moins développée, donc.
9 Bien que j’aurais tendance à penser qu’iels n’ont rien à gagner à revendiquer une coupure du reste des travailleur·euses.