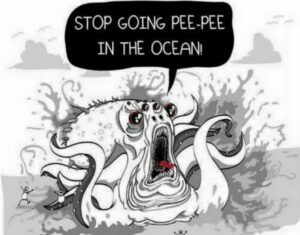Face aux débats suscités par la tenue de la Coupe du Monde de Football au Qatar en 2022, le Président de la République Emmanuel Macron déclara – avec l’aplomb qui le caractérise – : « Il ne faut pas politiser le sport ». Quel rapport avec les imaginaires ? Ce que révèle cette phrase du président Macron1, c’est sa vision du sport comme une pratique « gratuite », c’est-à-dire qui n’a d’autre signification qu’elle-même, que la célébration de la « beauté du geste » technique et de la performance virtuose. En somme, le président Macron voit le sport comme d’autres la pratique artistique (celle d’un instrument de musique, par exemple) et la littérature : un objet pur, sacré, objet d’une communion autotélique et détachée du reste de la réalité sociale.
Ce postulat d’une neutralité de l’art – et du sport – n’a rien de nouveau, bien au contraire. On peut, par exemple, citer Nietzsche : « La lutte contre la fin en l’art est toujours une lutte contre les tendances moralisatrices dans l’art, contre la subordination de l’art sous la morale. »i. Nietzsche a raison de parler de « lutte » : la vision de « l’art pour l’art » est violemment antagoniste à celle d’une politisation des imaginaires, et ce, d’autant plus qu’elle est socialement située, ainsi que l’a depuis longtemps montré la sociologie.
Le « désintéressement »ii, c’est à dire la croyance dans « l’intention pure de l’artiste » de de se placer tout d’un bond au-dessus de l’humanité et de n’avoir en commun avec elle qu’un rapport d’œil » est, comme l’a montré Pierre Bourdieu, la caractéristique du rapport à l’art des classes dominantes. Les classes « populaires », elles, montrent un « rapport éthico-pratique »iii à l’art : le travail d’Élodie Hommel confirme que les lecteur·ices des littératures de l’imaginaire cherchent (et trouvent) dans leurs lectures des figures et des exemples de comportements à valoriser ou non. Ainsi, « tout se passe comme si « l’esthétique populaire » […] était fondée sur l’affirmation de la continuité de l’art et de la vie » et qui « attend de toute image qu’elle remplisse une fonction » au contraire d’une esthétique dominante, légitime, bourgeoise qui, elle, cultive son « regard » distant et « l’ignorance active ou passive du contexte historique »iv, faisant par là-même fi de ce que « l’« œil » est un produit de l’histoire reproduit par l’éducation » et de ce que « Le regard « pur » est une invention historique qui est corrélative de l’apparition d’un champ de production artistique autonome ».
Autrement dit, « ne pas politiser » la littérature (ou le sport) est un comportement socialement situé : celui d’un individu appartenant à une classe pour qui la littérature est un moyen de distinction par son refus de la transitivité. Si la littérature a une valeur, c’est justement parce qu’elle n’a pas de valeur d’usage immédiatement perceptible : elle « vaut » précisément parce qu’elle ne sert à rien.. Si le goût est classant, le goût « pur » et intransitif classe, c’est que « la perception esthétique, en tant qu’elle est différentielle, relationnelle » : on n’aime que par rapport à ce que l’on aime pas. Affirmer la gratuité des imaginaires, c’est non seulement se positionner contre l’idée qu’ils puissent servir à quelque chose, et dans le même geste disqualifier les tenants de la posture inverse.
C’est la posture des classes dominantes – dans le champ de l’art, comme en dehors – et, à ce titre et puisque « à toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes », elles trouvent un écho parmi les autres classes : la posture de « pureté » est reprise, dans une variante profane, par l’idée de l’« escapisme », de la littérature et des imaginaires comme de simples « divertissements ». Il s’agit ainsi d’échapper au monde, en faisant un pas de côté, là où les classes dominantes se passent au-dessus des contingences sociales et historiques, en revendiquant « éternité et ubiquité, [qui] sont les attributs divins que s’octroie un observateur pur ».
Donc, ce que j’appelle la « neutralité axiologique » en littérature est soit un privilège de classe et de genre, soit son appropriation par des membres d’une classe dominée sous forme d’évitement de la conflictualité. Pour pouvoir revendiquer la gratuité, il faut pouvoir « se le permettre » et, au risque d’une formule provocante, j’avancerai que ceux qui le font sont souvent ceux qui n’ont pas grand-chose à perdre ni à défendre, mais aussi ceux qui ont à y gagner. La neutralité, la pureté, l’ambiguïté et l’équivoque sont le privilège de celleux qui n’ont rien à gagner à prendre position et, par conséquent, tout à y perdre, ceux qui ne le font que lorsque cela ne leur coûte rien et leur rapporte des biens symboliques, ou bien ceux qui ne le font que pour défendre la domination établie. Dans le cas des producteur·ices littératures de l’imaginaire, la revendication de « simples expériences de pensée » est la symétrique de celle de « n’écrire que des histoires », les explorations métaphysiques (masculines) sont le pendant de la « cozy fiction ». Schématiquement la Hard-SF « neutre » et « scientifique »s’oppose à la fantasy légère et à la romance.
Revenons à Nieztsche. À quoi opposait-il l’art ? À « la morale », et mêmes à « ses tendances moralisatrices. » Pour prendre un exemple très contemporain, c’est la « moraline » ou « la bien-pensance » que les tenants de la « séparation de l’homme et de l’artiste » opposent à celleux qui protestent la valorisations d’artistes accusés (ou même condamnés) pour des violences sexistes et sexuelles. L’affirmation d’un lien d’identité entre un.e artiste et son œuvre remet en question la doctrine de la « pureté », bouscule la neutralité du lecteur·ice : comment en effet, ne pas être moralement mis en difficulté dans son appréciation « pure » de l’œuvre d’un violeur, d’un raciste, d’un assassin quand on nous rappelle « la relation métonymique entre l’auteur et l’œuvre ? ».
C’est qu’on attribue, symboliquement et historiquement, à l’artiste – au producteur d’imaginaire – un rôle, un pouvoir de transgression des « valeurs morales ». C’est l’imaginaire du « bouffon du roi », dont la fonction serait d’être la conscience moqueuse du souverain, de dire au pouvoir ce qu’il ne veut pas entendre et que tout autre que lui serait puni pour dire. Cet imaginaire de la transgression comme contre-pouvoir a toutefois le défaut de pouvoir être repris par les forces conservatrices (« On ne peut plus rien dire », etc.). L’écrivain de fantasy satirique Terry Pratchett mettait lui une condition importante à cette nécessité de transgression : « Le rôle de la satire est de ridiculiser le pouvoir. Celui qui rit de ceux qui souffrent n’est rien qu’une petite brute. Visez vers le haut ! »
Ce pouvoir de transgression prend souvent, selon le Bourdieu, la force d’un « agnosticisme moral », c’est-à-dire de décrire de représenter des faits moralement répréhensibles, violents par exemple, sans se prononcer à leur égard, explicitement ou implicitement : il s’agit de « tout constituer esthétiquement par la vertu de la forme ». Cet « esthétisme, qui, en constituant la disposition esthétique en principe d’application universelle, pousse jusqu’à sa limite la dénégation bourgeoise du monde social » se double souvent d’une prétention à la métaphysique, une « distance élective aux nécessités du monde naturel et social », une prétention particulièrement sensible dans une certaine science-fiction blanche et masculine qui dit questionner « les grandes questions de l’homme » (sic), la « nature humaine », en utilisant les genres de « l’imaginaire » comme un outil d’abstraction, de désensibilisation et de dépolitisation ; bref un parfait exemple de la « simple délectation » de l’esthétique bourgeoise dont la caractéristique principale est d’effacer tout réel enjeu de pouvoir.
Pierre Tevanian va plus loin. Selon lui, « la moins tonalité morale apparaît dans cette axiologie comme l’infraction par excellence, la faute de goût, le faux pas qui vous précipite dans des abîmes infrapolitiques méprisables »v. A l’inverse, se présenter comme amoral ou « apolitique » est extrêmement profitable symboliquement : c’est ce qu’il appelle la « prime à la dégueulasserie » ou, de manière plus diplomatique « le double standard immoraliste » (c’est lui qui souligne). Sa réflexion rejoint le travail de Pierre Bourdieu et de Bernard Lahire car ce « double standard » est un « préjugé classiste caractérisé, selon lequel les sentiments moraux [et, ici, amoraux] sont l’apanage des classes supérieurs, et les instincts celui du « bon peuple ». »
Ces développements montrent que le champ des imaginaires, loin d’être uniforme, est lui aussi traversé par ce que Françoise Héritier appelait « valence différentielle des sexes », selon laquelle le social est construit sur une séries d’oppositions entre masculin et féminin. Pour ma part, j’amenderai la formule d’Héritier en parlant plutôt de « valence différentielle de genre et de classe ».
Le champ des imaginaires est donc traversé et structuré par une série d’oppositions, toutes déterminées par les conditions historiques et sociales de production des œuvres : haut/bas, apolitisme/militantisme, amoralisme/moralisme, masculin/féminin, âgé/jeune, « classe-moyenne »/précaire, professionnel/amateur, esthétique/commercial, sérieux/futile, littéraire/« pulp », intellectuelle/divertissement, philosophique/psychologique, et… SF/Fantasy.
Ces réflexions théoriques me paraissent indispensable si nous voulons parvenir à une politique des imaginaires. Je voudrais en conclusion de ce texte donner à lire une citation du regretté Fredric Jameson, qui résume sans doute mieux que je ne peux le faire l’absurdité de la dichotomie entre le « politique » et le « non politique », et réduit à néant la prétention à la neutralité axiologique des productions esthétiques :
La distinction bien pratique entre les productions culturelles sociales et politiques et celles qui ne le sont pas devient pire qu’une erreur : c’est à dire, un symptôme et un soutien à la réification et la privatisation de la vie contemporaine. Une telle distinction réaffirme que l’écart structurel, l’écart conceptuel et l’écart d’expérience entre le public et le privé, entre le social et le psychologique, ou entre le politique et le poétique, entre l’histoire ou la société et « l’individu » qui – et il s’agit de la loi tendancielle de la vie sous le capitalisme – mutile notre existence en tant que sujets individuels et qui paralyse notre pensée sur l’époque et le changement autant qu’elle nous aliène de notre parole même. Imaginer que, à l’abri de l’omniprésence de l’histoire et de l’implacable influence du social, il existe déjà un monde liberté – qu’il s’agisse de l’expérience microscopique des mots d’un texte ou de l’intense extase des différentes religions – ne fait que resserrer l’étreinte de la Nécessité sur ces points aveugles dans lesquels le sujet se réfugie, à la recherche d’un projet de salut seulement psychologique et purement individuel. La seule véritable libération de ces contraintes commence avec la reconnaissance qu’il n’y a rien qui n’est politique et historique – en effet, « en dernière analyse », tout est politique.vi
Que faire alors face à « ceux qui […] pensent encore que la sensibilité culturelle ou esthétique est une chose innée ou inéducable » ? « Bourdieu « abolir la frontière sacrée qui fait de la culture légitime un univers séparé » », autrement dit, comme Freya, la protagoniste d’Aurora, (Kim Stanley Robinson, 2015). ramener l’art, la littérature, l’imaginaire sur Terre, et réapprendre à y marcher.
*
1 Outre son indifférence totale au désastre environnemental qu’a constitué cet événement sport, sa désinvolture face aux violations des droits humains au Qatar et plus particulièrement en ce qui concerne les travailleurs étrangers qui avaient construit les stades, et son hypocrisie, lui-même ne manquant jamais une opportunité d’utiliser les événements sportifs pour abonder son capital symbolique en s’affichant de gré ou de force auprès d’athlètes victorieux.
i Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, « Flâneries inactuelles », § 24, Trad. E. Blondel, O. Hansen-Løve, T. Leydenbach et P. Pénisson, Flammarion, 1996.
ii Pierre BOURDIEU, La Distinction, Minuit, 1979
iii Bernard Lahire, La Culture des individus – Dissonances culturelles et distinction de soi, La Découverte, 2004
iv Pierre BOURDIEU, Les Règles de l’art – Genèse et structure du champs littéraire, Seuil, 1992
v Pierre Tevanian, Soyons Woke, Divergences, 2025
vi Fredric JAMESON,L’inconscient politique – le récit comme acte socialement symbolique, trad. Nicolas Vieillescazes, Questions Théoriques, 2012